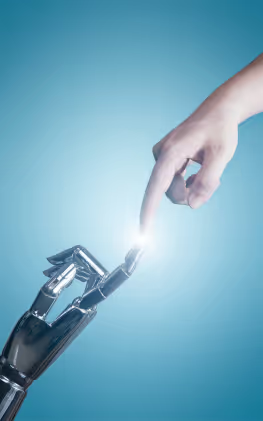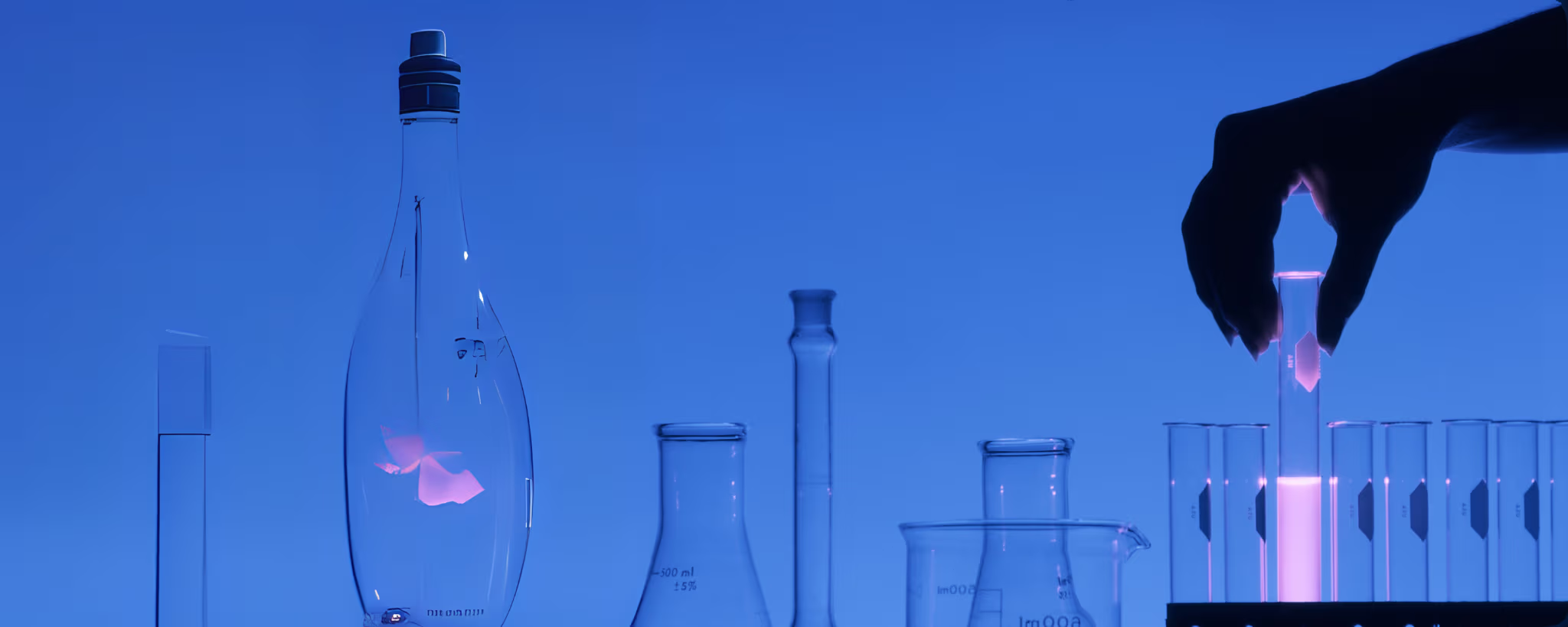Pourquoi la recherche de données freine l’innovation dans les laboratoires
Dans les équipes R&D, les ingénieurs passent chaque jour un temps considérable à chercher des informations au lieu de les exploiter. Cette inefficacité invisible ralentit les projets, fragilise les décisions et coûte cher à long terme. Mais ce n’est pas une fatalité : la digitalisation des données techniques permet de transformer ce point faible en véritable levier de productivité.
Données dispersées, temps perdu
Dans de nombreux laboratoires, la recherche d’informations reste un frein quotidien. Les données sont dispersées entre des tableaux Excel, des dossiers locaux, des bases de données internes ou des systèmes externes non connectés. Chaque collaborateur suit ses propres conventions de nommage et d’organisation, ce qui complique encore l’accès rapide à l’information.
À cela s’ajoute la complexité liée à la multiplicité des outils : systèmes ERP, CRM, bases qualité ou fichiers partagés utilisent tous des interfaces et logiques différentes. Résultat : les équipes passent trop de temps à chercher au lieu d’analyser, ou pire, à reconstituer des données pourtant déjà disponibles. Trop souvent, une réponse claire n’arrive qu’après plusieurs échanges internes ou un nouveau test en laboratoire.
Des conséquences concrètes sur les coûts et la performance
Ce manque d’accès aux bonnes données au bon moment a un impact direct sur l’efficacité :
- Retards dans la libération des lots de production, avec des conséquences financières sur la logistique, les pénalités contractuelles ou la satisfaction client.
- Allongement des délais de développement produit, qui réduit la réactivité face aux demandes du marché et augmente les coûts de R&D.
- Complexité accrue lors du départ de collaborateurs expérimentés, car leur savoir reste souvent non documenté et difficilement transmissible.
- Allongement des temps de réponse face aux réclamations, ce qui dégrade l’expérience client et mobilise inutilement les équipes.
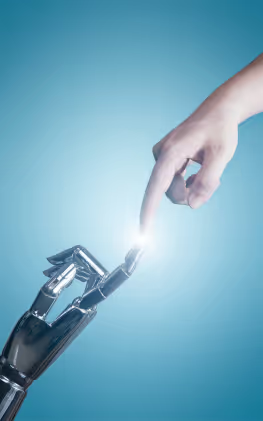
Pourquoi les données restent sous-utilisées
Plusieurs obstacles expliquent pourquoi les données disponibles ne sont pas pleinement exploitées : absence de codification commune, stockage sur des serveurs difficilement accessibles, formats hétérogènes, multiplicité des langues ou encore cloisonnement organisationnel. À cela s’ajoute une culture qui valorise l’action plus que la structuration des connaissances.
L’intelligence artificielle au service de la recherche d’information
Grâce aux dernières avancées en IA, il est désormais possible d’extraire automatiquement l’information pertinente à partir d’un grand volume de données. Des assistants intelligents permettent de naviguer rapidement dans des bases complexes, d’identifier les documents et paramètres utiles, et de proposer des liens entre des données a priori non connectées.
La clé pour que ces outils fonctionnent : une base de données unifiée, structurée et bien entretenue. Lorsqu’elle est en place, l’assistant devient une interface intuitive entre l’utilisateur et la connaissance du laboratoire.
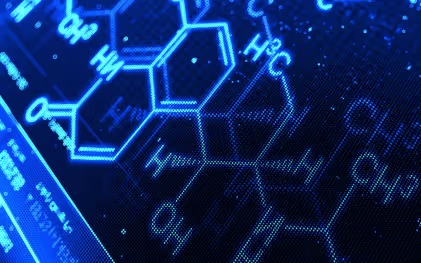
Quatre gains mesurables
- Temps de recherche divisé : les données sont indexées, catégorisées et accessibles via un moteur sémantique. Plus besoin de fouiller des dizaines de fichiers manuellement.
- Moins de doublons, plus d’efficacité : les réponses aux questions sont centralisées. Cela évite les tests redondants, les validations multiples et les transferts d’information informels.
- Capitalisation du savoir : le départ d’un expert ne signifie plus la perte d’années d’expérience. Les données deviennent un patrimoine structuré, transmissible et durable.
- Décisions plus rapides : en R&D, chaque heure compte. L’accès instantané à l’information permet d’avancer plus vite, de mieux répondre aux exigences clients et de sécuriser les choix techniques.
Vers une gestion intelligente de la connaissance
La digitalisation des données techniques ne se limite pas à l’archivage ou à la mise en conformité documentaire. C’est un facteur clé pour améliorer la performance opérationnelle, soutenir l’innovation et accélérer la prise de décision. LabV s’inscrit pleinement dans cette logique : en centralisant les données issues du laboratoire, en les structurant et en les rendant accessibles via des assistants intelligents, la plateforme permet à chaque équipe de travailler avec les bonnes informations, au bon moment.
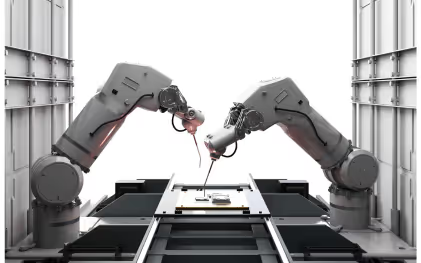
L'hyperautomatisation développe son potentiel en particulier dans les domaines gourmands en données, tels que la planification et la réalisation de tests de matériaux : les processus peuvent être considérablement accélérés, les sources d'erreur minimisées et les capacités libérées pour des tâches plus exigeantes.
L'un des aspects essentiels de l'hyperautomatisation est l'intégration fluide de différentes sources de données et de différents systèmes. Cela permet aux équipes de R&D d'automatiser entièrement des tâches telles que la fusion des résultats de tests provenant de différents systèmes de laboratoire ou la génération automatique de rapports. Ces flux de travail cohérents permettent non seulement de gagner du temps, mais garantissent également une transparence et une traçabilité accrues au sein des projets, ce qui constitue un avantage décisif dans les processus complexes de recherche et développement.
L'hyperautomatisation ouvre également de nouvelles opportunités dans le développement de matériaux grâce à l'utilisation d'algorithmes basés sur l'IA. De cette manière, des simulations et des analyses peuvent être effectuées automatiquement sur la base de données historiques afin d'identifier des stratégies de test optimales. Ces technologies soulagent les équipes de R&D en effectuant des tâches de routine de manière efficace et fiable en arrière-plan, tout en créant un espace pour un travail créatif et stratégique.
L'utilisation intensive de technologies intelligentes fait donc de l'hyperautomatisation un levier central pour raccourcir les délais de développement, améliorer la qualité et mettre les innovations sur le marché plus rapidement. Pour les équipes de R&D, cela signifie une transformation fondamentale vers des processus plus efficaces, flexibles et durables.
Tendance #4 : Développement de matériaux basé sur les données
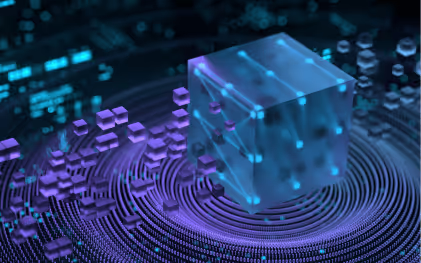
La capacité à analyser et à utiliser systématiquement les données deviendra un facteur de succès décisif dans la recherche et le développement en 2025. Les quantités sans cesse croissantes de données issues des tests de matériaux, des simulations et des processus de production offrent un énorme potentiel pour prendre des décisions éclairées et rendre les processus de développement plus efficaces.
L'intégration de diverses sources de données dans une plate-forme centrale constitue un élément central du développement piloté par les données. Les résultats des tests historiques, les paramètres de production et les résultats de simulation peuvent être liés entre eux de manière à créer une image complète des propriétés des matériaux et de leurs applications potentielles. Ces plateformes d'intelligence matérielle créent non seulement de la transparence, mais permettent également des prédictions précises basées sur des données, par exemple sur la formulation optimale ou le comportement d'un matériau dans des conditions spécifiques.
En outre, les analyses basées sur l'IA ouvrent une nouvelle dimension à la prise de décision. Des modèles qui seraient à peine reconnaissables manuellement dans les volumes de données peuvent être identifiés automatiquement afin d'accélérer les processus d'innovation. Dans le domaine du développement de matériaux, cela implique d'acquérir des informations précieuses à partir de projets précédents et de planifier la prochaine génération de matériaux de manière ciblée.
Les tests en conditions réelles peuvent être remplacés par des simulations, ce qui raccourcit considérablement les cycles de développement, minimise les risques et ouvre la voie à des solutions innovantes.
Mais le développement piloté par les données ne s'arrête pas à l'analyse. Des technologies telles que le jumeau numérique, une réplique virtuelle d'un objet physique, permettent de remplacer les tests réels par des simulations. Cela raccourcit considérablement les cycles de développement, minimise les risques et crée un espace pour des solutions plus durables et innovantes. Pour les équipes R&D, cela représente un avantage décisif pour répondre plus rapidement aux défis de demain.
Avec le développement piloté par les données, les « données », matières premières, deviennent un facteur clé du succès de la R&D. Les équipes qui utilisent les données de manière stratégique et efficace peuvent non seulement réagir plus rapidement aux changements, mais également renforcer la force d'innovation de leur organisation sur le long terme et s'assurer des avantages concurrentiels.
Tendance #5 : Coopération et interdisciplinarité
Les exigences en matière de développement des matériaux continueront de devenir de plus en plus complexes en 2025, tandis que les frontières entre le laboratoire, la production et la recherche deviennent de plus en plus floues. Pour relever ces défis, les équipes de R&D s'appuieront de plus en plus sur la collaboration interdisciplinaire et les réseaux numériques.

Les projets de recherche et développement modernes nécessitent un échange continu de connaissances et de données au-delà des frontières des spécialistes et des départements. Des chimistes, des ingénieurs, des scientifiques des données et des experts en durabilité et en réglementation travaillent ensemble sur des solutions qui sont non seulement convaincantes sur le plan technologique, mais également durables et commercialisables.
Les plateformes numériques constituent un élément central de cette nouvelle forme de collaboration. Ils permettent aux équipes de travailler ensemble sur une base commune entre les départements et les sites. Les tests de matériaux, les résultats de simulation et les paramètres de production ne sont donc plus considérés isolément, mais intégrés dans un contexte holistique. Ces approches aident les équipes de R&D à surmonter des défis complexes, tels que le développement de matériaux durables ou l'intégration de nouvelles technologies, de manière plus efficace.
Un exemple pratique montre comment des équipes interdisciplinaires travaillent ensemble pour proposer des solutions innovantes : dans le cadre d'un projet de recherche visant à réduire les émissions de CO₂, des chimistes ont développé un nouveau catalyseur, des ingénieurs ont testé son évolutivité pour la production et des data scientists ont utilisé des modèles de simulation pour optimiser l'efficacité du processus. Cette étroite collaboration a non seulement permis d'obtenir des résultats plus rapides, mais a également permis un lancement réussi sur le marché.
Outre les avancées technologiques, l'importance des compétences générales est de plus en plus mise en avant. Les entreprises favorisent la collaboration entre les disciplines grâce à des méthodes de travail agiles et à une culture de communication ouverte. Les équipes qui partagent efficacement leurs connaissances et travaillent ensemble pour résoudre des problèmes bénéficient de cycles de développement plus courts et d'une capacité d'innovation accrue.
La coopération et l'interdisciplinarité sont donc bien plus qu'une simple tendance pour 2025 : elles marquent un changement fondamental dans la recherche et le développement de matériaux. Pour les équipes de R&D, cette approche est cruciale pour répondre avec succès aux demandes croissantes du marché et de la société.
Conclusion — les cinq tendances en matière de R&D en 2025
Les cinq tendances présentées pour 2025 — de la durabilité et de l'hyperautomatisation au développement piloté par les données et à la collaboration interdisciplinaire — montrent à quel point le monde de la recherche et du développement continuera à évoluer de manière dynamique. Mais au milieu de toutes ces évolutions, il existe un dénominateur commun : l'intelligence matérielle.
L'intelligence matérielle est la capacité à connecter intelligemment les données, les technologies et les personnes afin de prendre de meilleures décisions et de commercialiser plus rapidement des matériaux innovants. Il s'agit bien plus qu'une simple solution technologique, c'est une approche stratégique qui permet de gérer les défis liés au développement des matériaux. Grâce à l'utilisation ciblée de plateformes modernes, d'analyses alimentées par l'IA et de flux de travail intégrés, les données deviennent de véritables connaissances qui aident les équipes de R&D à obtenir des résultats plus durables, efficaces et précis.
Les équipes qui adoptent cette approche répondent non seulement aux défis d'aujourd'hui, mais façonnent également la recherche sur les matériaux de demain. L'intelligence matérielle n'est donc pas une vision, mais une réalité pour longtemps. En 2025, elle sera plus que jamais la technologie clé pour le paysage R&D de demain.